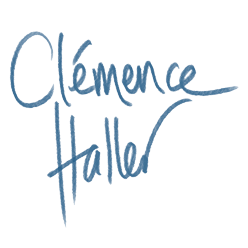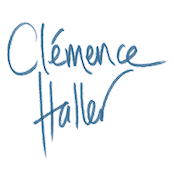[et_pb_section fb_built= »1″ _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][et_pb_row column_structure= »3_5,2_5″ _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][et_pb_column type= »3_5″ _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][et_pb_post_title featured_image= »off » _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default » hover_enabled= »0″ author= »off » sticky_enabled= »0″][/et_pb_post_title][et_pb_text _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »]
Ecrire un journal, à quoi cela peut-il bien servir ? Tout au long de ma vie, je me suis posé cette question, à différents niveaux. L’écriture d’un journal est-il utile, pour qui, pourquoi et dans quel but ? Je vais tenter de répondre à ces questions, en citant des passages d’un texte réflexif écrit au cours de ma formation d’enseignante. J’ai commencé l’écriture d’un journal de bord professionnel, au début de ma formation. Et dès les premiers mots, je me suis rendu compte des bienfaits : j’ai ressenti un soulagement par le fait que les interrogations du moment se déposaient ailleurs que dans ma tête. C’est ce même effet que l’on ressent, lorsque l’on partage ses pensées avec son entourage. Pourtant, avec l’écriture, l’effet est plus constant, plus durable, car on a accès à nos écrits et on peut y revenir au besoin. Ecrire est donc un processus qui agit sur le long terme, à la différence de l’oral, instantané par nature.
Déposer mes idées dans un journal m’aide, car je m’y découvre, je cherche mes mots, mes tournures de phrases, je veux encore améliorer une idée, la développer en la liant avec une nouvelle idée. En fait, je me mets à nu dans l’écriture : je dois creuser à l’intérieur de moi pour trouver matière à écrire, je ne peux que me dire, me raconter, m’offrir à moi-même et au lecteur improbable. C’est impossible de me cacher à moi-même, car les mots viennent du tréfonds de mon être. Certes, j’enjolive, je choisis mes mots mais je précise par là-même mes idées.
Une fois sur le papier, l’évènement même évolue. Le « je » du narrateur lui enlève toute neutralité. Personne ne peut écrire dans l’indifférence, l’action se rejoue, se repense, se ressent à nouveau. (Myftiu)
C’est en fait le début du partage, car communiquer avec un substitut de soi, c’est déjà poser les bases de la communication avec autrui : cela permet d’envisager la manière la plus adéquate d’en parler. Déposer ses idées et réflexions permet aussi d’avoir un espace pour s’exprimer librement et représente aussi une étape supplémentaire de compréhension.
En écrivant son histoire sous forme de récit, l’auteur apprend sur lui-même, apprend de lui-même, et par lui-même. « Connais-toi toi-même, c’est là toute la science » note Nietzsche dans Aurore, alors que dans Humain, trop humain, il compare ceux qui refusent de se connaître à des voleurs : « Ceux qui se cachent à eux-mêmes une part d’eux-mêmes et ceux qui se cachent tout entier, se ressemblent en cela qu’ils commettent un vol au trésor de la connaissance ».
Au-delà de cet usage, je veux transmettre l’envie d’écrire, montrer pourquoi j’aime lire et écrire, à quoi cela me sert. Dire aussi qu’« un texte n’est pas facile à fabriquer. Chacun se sait incapable d’écrire la plupart des textes qu’il lit pourtant sans beaucoup de peine. » (Hébrard). Et faire prendre conscience que chaque apprentissage demande du temps et du travail, que l’on soit élève, étudiant ou adulte… Selon Astolfi, « écrire, c’est former et transformer sa pensée. Il n’y a pas d’écriture sans réécriture. »
Et si l’écriture n’était pas là, comment ferais-je pour évacuer les idées qui prennent tant de place dans ma tête ? Aragon surenchérit : « Je crois aujourd’hui encore qu’on pense à partir de ce qu’on écrit, et pas le contraire. » Et peu-à-peu, écrire devient une habitude de vie, que je réalise de préférence dans le même cahier, symbole d’un compagnon, un autre moi, qui m’accompagne dans la découverte du monde et de moi-même.
L’écriture peut ainsi « déplier » les situations évoquées. Elle suspend l’allant de soi qui se constitue avec la fausse évidence. Ce qui était devenu « naturel » est interrogé. On ouvre. Une compréhension s’élabore. (Cifali & André).
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type= »2_5″ _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][et_pb_image src= »http://histoiresdevie.charon.preview-kreativmedia.ch/wp-content/uploads/2021/06/notebook.jpg » title_text= »notebook » _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default » hover_enabled= »0″ sticky_enabled= »0″][/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]